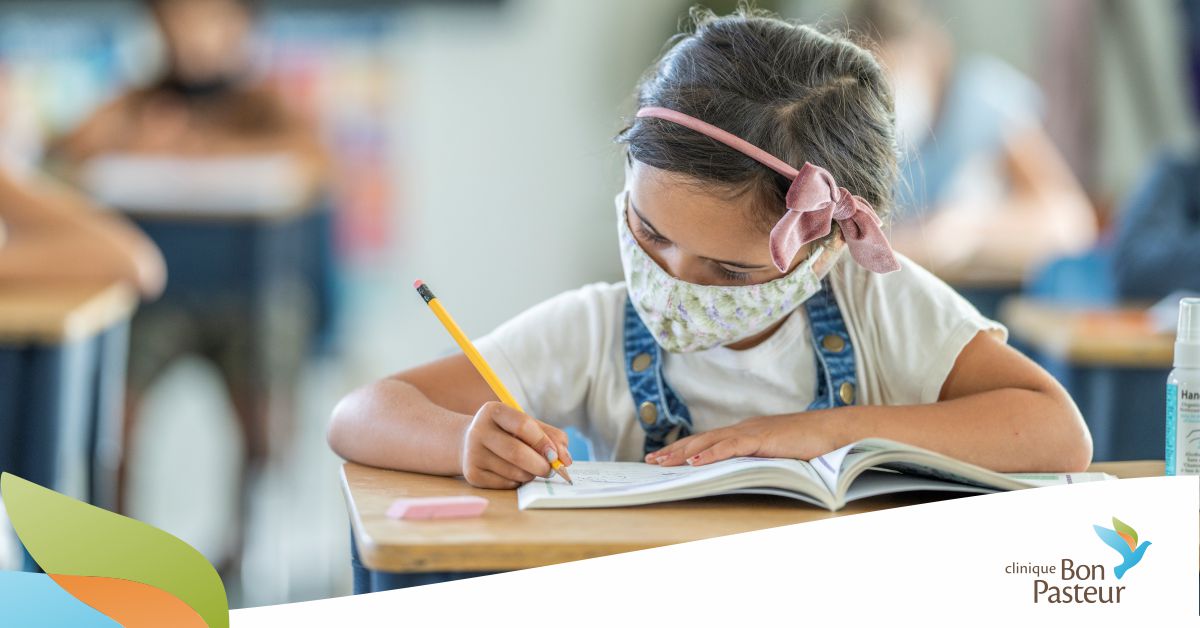Puisque la Clinique Bon Pasteur a à cœur la sécurité et la santé de ses employés et collaborateurs comme de ses patients et visiteurs, de nombreux travaux ont été enclenchés cette année pour offrir à tous un espace de vie optimal. Anju Teeluck, Health & Safety Officer, et Mario Sandian, chargé de maintenance à la Clinique, nous en disent plus.
Rédigée en 2008, la politique de Health and Safety connaît, au fil des années, de nombreux remaniements pour répondre au mieux à tous les aspects de la sécurité et de la santé à la Clinique. « Notre politique touche à de nombreux sujets et définit notamment la responsabilité de chacun, en particulier celle de l’employeur envers ses employés, mais aussi le suivi des préoccupations signalées en matière de santé et de sécurité ainsi que la mise en œuvre des mesures correctives recommandées », explique Anju. À cela s’ajoutent aussi la mise en place de formations pour s’assurer que les pratiques de travail appropriées sont suivies, ainsi que l’examen et l’amélioration de tous les processus.
Car une bonne politique santé et sécurité représente une solution gagnante pour toutes les parties. « Nous ne nous conformons pas seulement à la législation, nous assurons aussi à tous un environnement sécurisé, où il fait bon travailler ou séjourner, ce qui est non seulement bénéfique quant à l’engagement de nos collaborateurs et clients, mais engendre aussi des résultats positifs sur le long terme pour la clinique avec, par exemple, l’arrivée de nouveaux médecins réputés », poursuit Anju. Pour l’année 2022, la Clinique met donc les bouchées doubles pour améliorer ses locaux.
Parmi ces travaux, la création d’une nouvelle salle d’opération et la rénovation des deux salles existantes pour répondre au mieux aux besoins des patients et des employés. « Tout a été pensé selon les normes internationales. Par exemple, notre nouveau système de climatisation centralisé permet, grâce à son filtre HEPA, d’approvisionner les salles en air pur, réduisant donc le risque d’infection », dit Mario. Parallèlement, des travaux d’embellissement de la cour d’entrée, avec la création de petits jardins avec une irrigation automatique et un nouvel asphaltage, promettent un cadre de vie amélioré.
Le réaménagement du parking, toujours en cours, est un projet qui pèse lourd dans la balance sécurité. « En plus de l’avoir rénové, nous prévoyons aussi de mettre en place un portail automatique et un système de tickets pour un meilleur contrôle de l’accès », ajoute Mario. L’objectif : réduire au maximum les risques d’accidents et d’incidents en améliorant la circulation des véhicules. La rampe installée pour les personnes à mobilité réduite a, elle aussi, était refaite pour faciliter l’accès aux salles de consultation.
Si les travaux sont nombreux, toutes les précautions sont prises pour assurer un chantier sécurisé pour tous. « Les travailleurs possèdent des équipements aux normes de sécurité et travaillent sous la supervision d’un entrepreneur expérimenté et d’un chef de projet. Certains accès sont restreints et nous nous assurons de réduire au maximum le bruit pour ne pas gêner le quotidien des employés et patients », dit Anju. La plupart de ces travaux étant toujours en cours d’exécution, c’est un visage moderne et frais que la Clinique promet de dévoiler, pour le plus grand bonheur de ses collaborateurs et visiteurs.