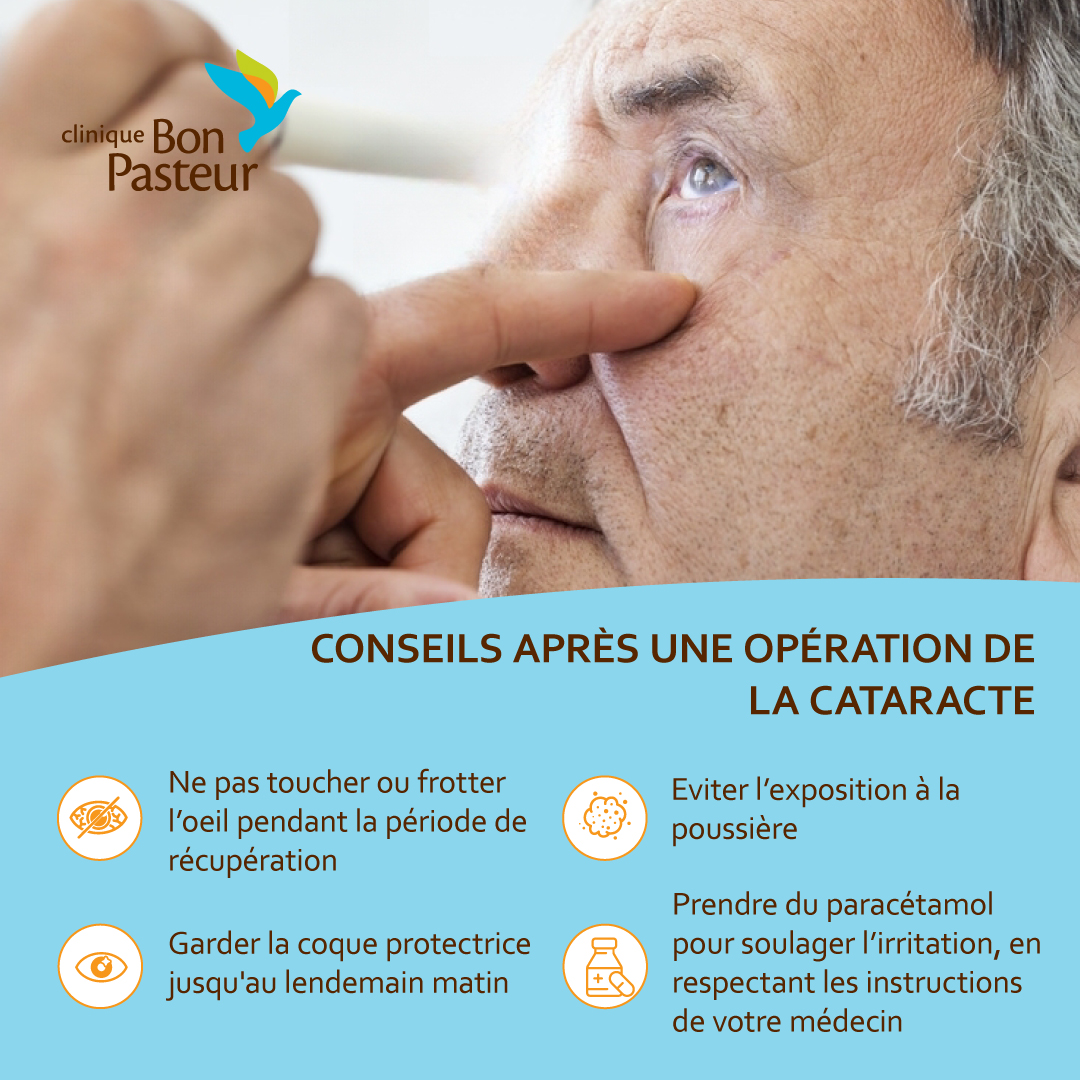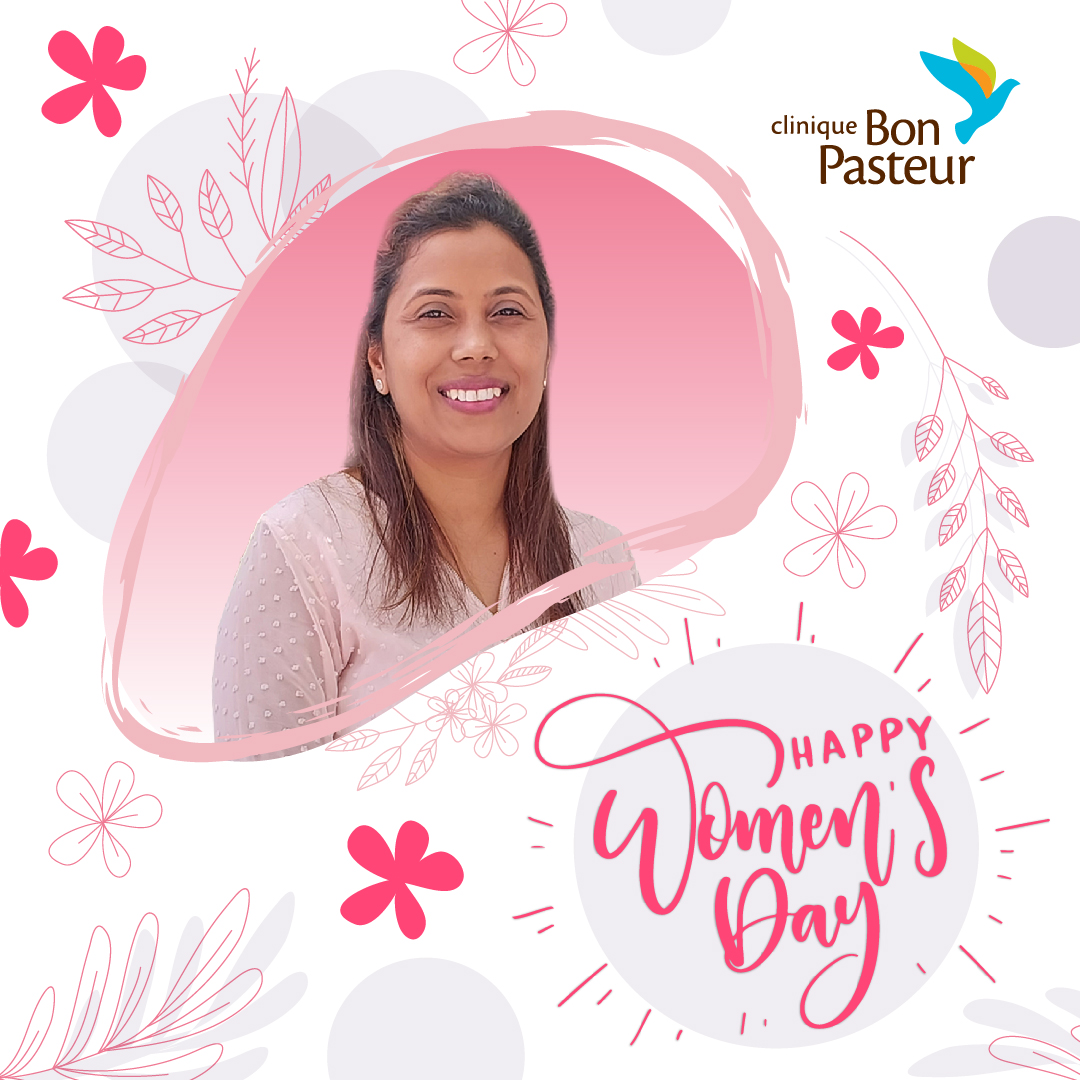Chirurgie orthopédique
Spécialité touchant au traitement chirurgical et à la correction de diverses déformations et blessures, la chirurgie orthopédique couvre décidément un large domaine ! Et pourtant, certaines affections, plus courantes, font, le plus souvent, le quotidien de tout chirurgien orthopédique qui se respecte. Retour sur la question avec le Dr Panchoo, chirurgien orthopédique à la Clinique Bon Pasteur.
Qu’est-ce qui emmène la plupart du temps une personne à consulter un chirurgien orthopédique ?
En chirurgie orthopédique, les motifs de consultation sont variables. Nous traitons, par exemple, les blessures ostéo-articulaires, les fractures, l’arthrose, les déformations osseuses ou encore les douleurs au cou ou au dos. Dans ma pratique, les patients viennent le plus souvent me voir pour des douleurs au bas du dos, au cou ou à l’épaule, de l’arthrose au genou, des blessures au genou résultant d’une activité sportive, des fractures et des entorses.
Quels sont les motifs qui nécessitent le plus souvent une opération ?
D’une façon générale, la chirurgie est faite pour contrôler la douleur, corriger une déformation et, surtout, améliorer la qualité de vie du patient. En orthopédie, il faut avant tout savoir faire la différence entre urgences chirurgicales et pathologies « froides » – qui n’exigent pas forcément une prise en charge immédiate. Toutes les urgences nécessitent une opération et c’est au chirurgien orthopédique de bien examiner le patient pour déterminer s’il y a urgence ou pas.
Il existe cependant des indications opératoires bien définies. Par exemple, la majorité des douleurs au cou et au dos sont dues à des hernies discales. Pour les traiter, on commence d’abord par un traitement conservateur consistant en une prise de médicaments, beaucoup de repos et des séances de physiothérapie. 90 % des patients répondent favorablement à ce traitement. La chirurgie n’est indiquée qu’en cas d’échec de ce traitement conservateur ou en présence d’un déficit neurologique.
Il en va de même pour l’arthrose du genou et de la hanche : nous proposons la chirurgie aux patients pour qui le traitement conservateur n’a pas eu l’effet escompté et ce afin d’améliorer leur qualité de vie. Les fractures déplacées, intra-articulaires ou ouvertes nécessitent, quant à elles, le plus souvent une intervention chirurgicale.
Dans ces cas de figure, comment se déroule l’opération ?
Pour les fractures exigeant une opération, nous pratiquons une réduction ouverte, suivie d’une fixation interne avec des implants. Ces derniers sont variables et dépendent de la localisation de la fracture. Par exemple, une fracture de l’avant-bras requerra des plaques vissées alors qu’un clou intramédullaire sera préconisé dans le cas d’une fracture du fémur.
Pour ce qui est des hernies discales, l’intervention chirurgicale est, une fois encore, variable et peut nécessiter une simple discectomie – qui consiste à enlever la hernie pour soulager la compression provoquée par celle-ci – comme une fusion lombaire.
Les stades avancés d’arthrose du genou ou de la hanche – où l’on note une certaine usure due à la perte de cartilage – peuvent, quant à eux, être traités par l’arthroplastie, c’est-à-dire par la mise en place d’un genou ou d’une hanche prothétique. Ces prothèses existent d’ailleurs pour la plupart des articulations : épaule, coude, poignet, cheville…
Pour les patients présentant une douleur à l’épaule, cette dernière résulte la plupart du temps d’une déchirure de la coiffe des rotateurs chez les personnes âgées et d’une instabilité chez les plus jeunes. Le traitement chirurgical consiste en une arthroscopie : le spécialiste examine l’articulation touchée grâce à un minuscule appareil optique inséré via une petite incision.
Enfin, les lésions méniscales et ligamentaires du genou peuvent elles aussi être traitées grâce à une arthroscopie, suivie d’une reconstruction ligamentaire.
Comment se passe le suivi post-opératoire ?
Toute intervention chirurgicale nécessite un suivi post-opératoire car il faut savoir que la chirurgie comporte évidemment des risques : risques d’infection, de saignement, de déficit neuro-vasculaire, etc. Un suivi est donc primordial car il permet de dépister précocement des complications, mais aussi de garder un œil sur la récupération et les progrès du patient.
La rééducation forme d’ailleurs un axe très important dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Nous travaillons en étroite collaboration avec des physiothérapeutes pour le bon déroulement du traitement : ces derniers doivent en effet suivre les consignes du chirurgien orthopédique en ce qui concerne les exercices à effectuer ainsi que la mobilité du patient.
Y a-t-il certaines précautions à prendre suite à une telle opération ?
Une fois encore, à chaque intervention son lot de précautions ! Selon l’opération et le traitement préconisé, le spécialiste expliquera au patient quels gestes et précautions adopter pour ne pas gêner le bon déroulement des suites post-opératoires.
Une chose est sûre : dans la plupart des cas, une bonne dose de repos est prescrite ! Le retour au travail ou à l’activité sportive sera ensuite déterminée par le chirurgien orthopédique avec, en ligne de mire, le bien-être du patient.